« Tu parles donc je suis [1] »
L’anthropologie des médias chez Edgar Morin et Pierre Schaeffer
- Coupures surréalistes
- L'atelier des archives
- L'amour est politique
- André Mare
- Antoine Vitez
- Georges Duby
- Christian Prigent
- Annales politiques et littéraires
- Les éditions BIAS
- Marguerite Duras
- Les éditions Larousse
- Les Éditions de L'Arche
- Violette Leduc
- Françoise Giroud
- Jean Paulhan
- La Galerie Breteau
- Les éditions Hachette
- Patrice Chéreau
- Éric Rohmer
- Dominique Bagouet
- Robert Kramer
- Alfredo Arias
- Edgar Morin
- François Zourabichvili
- Marianne Oswald
- Cornelius Castoriadis
- Françoise d'Eaubonne
- André Gorz
- Un conservatoire d'imaginaires
- Archives du genre
- Les éditions Grasset
- Franck Venaille
- Henri Maldiney
- Liberté, j'écris ton nom
- Edgar Morin
- Le béguinage des inventeurs
- Ruwen Ogien
- Denis Roche
- François Roustang
- Irène Némirovsky
- Les guides de voyage
- Georges Devereux
- Les fonds d’éditeurs à l’Imec
- Le portail des collections
- Léon Chertok
- Sarah Kofman
- Alain Badiou
- L’anthropologie des médias chez Edgar Morin et Pierre Schaeffer
- Dans l'amitié d'Arguments
- Hervé Guibert L’ange blessé
- Post-Censure(s)
- Les frères Dardenne Matière et mémoire
- Béatrix Beck En famille
- Jean-Louis Chrétien La parole blessée
- Hervé Guibert Regards troublés
- "Le Lieu de l'archive" entretien avec Nathalie Léger
- Maurice Olender par Nathalie Léger
- « Le marxisme est toujours là »
- Marx, un archipel
- Antonio Negri, histoires d’une vie
- Henri Lefebvre, une trajectoire singulière
- Daniel Bensaïd, un marxisme du sujet
- Alain Robbe-Grillet, aventurier du Nouveau Roman
- Michel Vinaver, explorateur du contemporain
- Jean-Loup Rivière, exposer la question
- art press, une archive du contemporain
- Henri Maldiney, dans l’atelier du phénoménologue
- Marcel Detienne. Remueur d'idées
- Pierre Daix Ruptures et fidélité
- Régine Deforges La liberté par les livres
- Les chemins buissonniers de Daniel Cordier
- Correspondance pour l’ailleurs
- Au cœur des archives éditoriales
- Aller partout. Les archives d'Hubert Damisch.
- Contemporaines ! Poètes-femmes d’aujourd’hui
- Boris Taslitzky
- La douceur du graveur Albert Mentzel-Flocon
- Jean Hélion et Francis Ponge
- Voir ce que devient l’ombre. Un portrait de Cécile Reims et Fred Deux par Matthieu Chatellier
- Fred Deux et Cécile Reims
- Dado
- La vaillance du libraire de La Porte étroite
- L’art se saisit de tout : les fonds artistiques conservés à l’IMEC
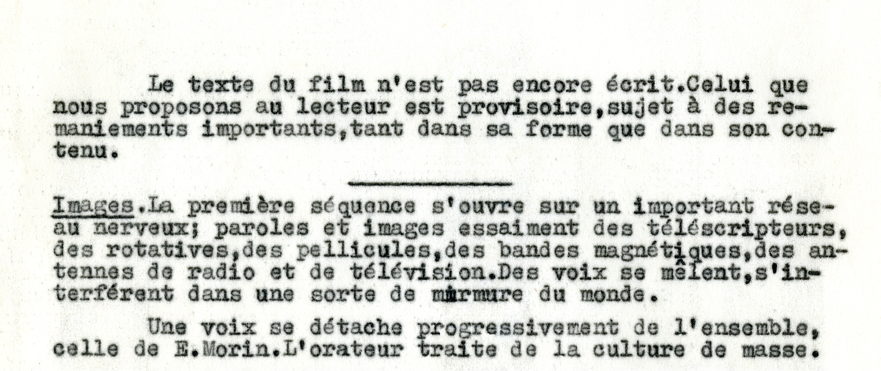
« Parler avec soi-même veut dire avant tout écouter » -
une voix à la télé dans Alice dans les villes de Wim Wenders.
« Toute ma Méthode expose ce point central : pas de connaissance d’un objet, pas d’objectivité, sans tentative d’auto-connaissance du sujet connaissant. […] Le concret c’est le complexe. Quand on comprend un homme dans toute sa complexité, on est dans son concret ».
Edgar Morin, « Le concret, Hegel », Mes philosophes, Fayard, Pluriel, 2013, p. 87.
En 1954, dans les Cahiers internationaux de sociologie, Edgar Morin annonce que le cinéma, dans la spontanéité de son développement foudroyant, « ne sait pas ce qu’il est [2]». Produit de la science dure (la photographie et l’empreinte chimique du paysage, la caméra et le mouvement physique enregistré, la décision optique, etc.), le cinéma est en même temps, paradoxalement, une fabrique d’histoires incroyables, d’images de rêves qui s’est transformée en art et en une industrie. Celle-ci est caractéristique de la société moderne mais le cinéma s’enracine dans certains traits profonds de l’être humain lui-même.
L’homme avait-il besoin du progrès de la science afin de pouvoir créer cette machine pour « se faire du cinéma », produire des histoires incroyables ou même reproduire des histoires réelles? Selon Morin, le précurseur du cinéma – le personnage « ombrageux » des cavernes préhistoriques, le Double, comme l’appelle Morin (1956) – fut déjà « chargé de mission » du cinéma d’aujourd’hui : cette mission consiste à pousser notre imagination dans des projections-identifications en satisfaisant par là le « besoin culturel ». Ce processus devint ainsi le moteur de la culture elle-même. La première archéologie du cinéma morinienne place l’homme « doué de déraison » au centre du progrès de l’humanité.
Dans «Préliminaire à une sociologie du cinéma », Morin souligne la portée anthropologique du cinéma : celui-ci advient à une étape « radicalement décisive de la conscience de l’être humain [3]» et dans ses pratiques multiples, il exprime cette nouvelle conscience dans le « devenir de l’être humain [3]»..Même un film scientifique sur les oiseaux nordiques, par exemple, restera toujours un film sur un mode d’attention que l’être humain peut ou pourrait porter au monde, une façon de le regarder, de l’habiter. Le cinéma - explique Morin – « engage profondément l’esprit humain et ce dernier s’engage dans et par le cinéma » [3]. Ainsi, le cinéma nous révèle l’homme en mouvement comme l’homme permanent en offrant une « conjonction totale inextricable du technique, du magique et de l’esthétique [4]».
La nouvelle conscience dont parle Morin « se produit, selon lui, par la dialectique cinématographique et incessante de l’objectivité et de la subjectivité [4]». La réalité filmique est toujours vue d’un seul angle, elle est donc présentée subjectivement. Pour la production de cette subjectivité, les procédés filmiques sont constitutifs. Mais le paradoxe du cinéma est que les matériaux d’enregistrement sont aussi subjectifs qu’ils paraissent objectifs. Pierre Schaeffer, l’acteur principal de la théorie acousmatique, fait une remarque similaire dans les Arts Relais (1941-1942), en ajoutant :
« L’homme n’est plus seul à ne voir que ce qu’il veut bien voir et à n’entendre ce qu’il veut bien entendre : il y a un partenaire. On a vu et entendu à sa place; il est dans l’enthousiasme et dans la réflexion [5]».
Le cinéma, comme attraction culturelle, suscite ainsi la curiosité dans la mesure où son contenu appartient non pas à la réalité des choses autour de nous, dont on a désormais l’illusion de maîtrise, mais à un autre : à un être humain comme moi.
Le caractère propre de la technique du cinéma – explique Morin – est de « présenter une subjectivité (des rêves, des mythes) objectivée et l’objectivité (les décors, la nature, les êtres) subjectivée » [6] grâce aux procédés cinématographiques, comme le montage, le cadrage qui participent à la construction d’une objectivité prétendue du film (la réalité filmique, sa fable). Ces procédés filmiques favorisent ainsi la fameuse projection-indentification [7] chez le spectateur.
D’où vient cette complexité du cinéma, que Morin considère comme formant une dialectique cinématographique ? – Nous voudrions ici reprendre et approfondir cette interrogation de Morin. – Est-elle vraiment propre au cinéma seul, et donc relativement nouvelle, ou bien provient-elle de la manière dite normale de penser les choses chez l’être humain et dans ce cas, date-t-elle même des « cavernes » dont parle Morin ? Autrement dit,: la complexité du cinéma est-elle alors la complexité naturelle de l’être humain lui-même ou bien le cinéma vise-t-il justement à en finir avec la complexité en son sens banal de « difficile », en cherchant un moyen ostensible et « facile » de penser et de présenter les choses (par l’intermédiaire de l’autre sujet qui fait le film)?
Certes, Morin, tout en cherchant à déterminer ce en quoi le cinéma nous change, s’intéressait surtout aux modes cinématographiques de la sociabilité et c’est à ce titre-là qu’il prête son attention aux questions techniques. Nous étudierons ici le mécanisme des procédés filmiques au prisme « anthropo-sociologique », et la critique qu’avancent Edgar Morin et Pierre Schaeffer de la notion d’Homo Sapiens à travers leur élaboration des médias, en nous interrogeant sur le procédé de la voix acousmatique au cinéma, en particulier à travers les idées de Pierre Schaeffer autour des Arts relais [8]. Ce procédé – acousmatique – semble-t-il, confirmerait d’une certaine manière la perspective de l’anthropologie sociologique du cinéma de Morin, à savoir que le cinéma nous dévoile l’être humain au plan historique et concret comme « doué de déraison ». En même temps, ce procédé est une métaphore cinématographique bien « lisible » par le spectateur et donc opératoire (comme instrument de pensée) de cette déraison dont nous serions tous doués.
Les procédés cinématographiques comme références à la réalité sociale
Même si le cinéma crée des images des rêves et des histoires fantastiques, il s’adresse en permanence au réel, se réfère à la réalité sociale. Cette attitude intéresse Morin-sociologue non seulement dans la mesure où le spectateur se projette dans les personnages ou reconnaît la manière de voir la réalité sociale comme juste (car un film reproduit souvent les situations de la « vraie vie » avec ses codes sociaux pour les reprendre dans les histoires de fiction), mais aussi comme le moment « actif » du cinéma qui participe à la construction des mythes sociaux, des nouveaux codes de comportements. Par exemple, la vie familiale hollywoodienne devient un exemple d’une famille idéale ; on imite involontairement le mode d’être une femme comme Marilyn Monroe ou d’un homme comme Humphrey Bogart, etc. Le star-système, qui existait déjà au théâtre, avec le cinéma, transforme les stars en icones archétypales du passé et du futur à la fois [9]. La star cinématographique est un avatar du Double des cavernes [10], en tant qu’étoile ou ombre projetée : on s’y reconnaît en se découvrant en même temps, comme un enfant face au miroir. Cette infantilité « caverneuse » est exploitée par le cinéma.
Morin nous invite à voir le cinéma à la fois comme preuve et comme outil du changement de la conscience humaine. Mais quels sont très concrètement ces outils qui permettent de produire ce nouveau renversement entre l’objectivité et la subjectivité et comment peuvent-ils nous éclairer sur l’humanité à cette nouvelle époque du cinéma ?
Pour Morin-cinéaste, la caméra – mais aussi tout outil technique du cinéma, comme l’écran, le projecteur et l’accompagnement sonore – est un de ces instruments qui permettent l’apparition de quelque chose de nouveau – non pas au sens où ils dévoileraient quelque chose d’invisible ou de non remarquable à l’œil « non-armé », mais en ce qu’ils révèlent ce qui ressort uniquement avec le cinéma et la caméra. Des dimensions inappréciables encore inconnues de la réalité sociale adviennent peut-être pour la première fois. Tel fut le projet filmique de Morin dans sa collaboration avec Jean Rouch pour Chronique d’un été, suivant ce principe du cinéma-vérité : « l’observateur observé » [11] comme « l’arroseur arrosé », le sujet auto-connaissant, « l’homme à la caméra » filmé lui-même etc.
Nous révèlent-ils vraiment, ces procédés inconnus, l’être humain comme un sujet se connaissant soi-même, en train de produire cette connaissance ou en train de faire une première rencontre ? Vu la production cinématographique contemporaine, il aurait été juste de remarquer que le cinéma exploite la tentative de l’être humain d’exprimer une certaine « connaissance de soi-même » dans la mesure où il cherche à créer des personnages « crédibles » dans leur comportement et leur manière de vivre. En même temps, une histoire filmique porte encore – voire peut-être toujours – sur l’incroyable, même s’il est plongé artificiellement dans l’ordinaire. C'est-à-dire que les éléments de cette histoire incroyable sont rendus saisissables et reconnaissables par le spectateur immédiatement et sans demander un déchiffrage compliqué. La question de la justesse est d’ailleurs mise en question dans ce film expérimental, lors de la discussion finale autour des « dévoilements » presque radicalement opposés des deux personnages du film : Marilu qui, selon les autres participants-spectateurs, « s’ouvre un peu trop » face à la caméra, et Marcelline, qui donne l’impression de « jouer un peu » sur son vrai passé qui est en vérité très dramatique.
Au cinéma, l’histoire filmique balance alors entre le crédible et l’incroyable. Et non pas « n’importe quel incroyable », mais l’incroyable paradoxalement justifié par la reconnaissance du spectateur, au sens où le spectateur se reconnaît dans la folie d’un personnage, par exemple, ou encore dans ce « rêve » de vivre sa vie ainsi, de manière impossible ; il se reconnaît dans les crimes et les victimes, dans les amoureux et les pervers ; dans un personnage qu’il n’aurait jamais été, mais aurait pu être, etc. Sa reconnaissance se fait à travers cette altérité même.
Ce balancement entre les deux extrémités existe bien sûr au théâtre. Cependant, au cinéma, l’objectivité prétendue d’un film, sa fable et l’histoire filmique se construisent par des procédés bien plus sophistiqués, comme l’a bien expliqué Morin dans Le cinéma et l’homme imaginaire. Ces procédés cinématographiques servent surtout à construire une situation qui ne peut pas être filmée telle quelle. [Nous sommes convaincus, cependant, que nulle situation ne peut être filmée telle quelle. Il n’y a pas de captation cinématographique, mais une rhétorique de l’image.] Si les acteurs, les choses et le décor existent vraiment (nous empruntons leur existence à « notre réalité » pour construire une réalité filmique), certains rapports entre eux sont à établir à l’aide du montage des images et des sons, de l’angle de la caméra, de la mise en scène filmée de plusieurs points de vues et la succession de ces scènes. Le cinéma ne ment pas sur l’existence des choses filmées, mais invente et construit les relations entre elles et nous. Ainsi, dans Nuit et Brouillard, par exemple, le décor est celui des camps mais le film se fait par la juxtaposition de ces lieux silencieux avec la voix-off qui vient du hors-champ.
Pour donner un exemple plus singulier: le procédé de la voix acousmatique découvert par la théorie homonyme est utilisé afin de créer l’effet de la folie hallucinatoire. Ainsi, dans Psychose de Hitchcock, par exemple, il s’agit de créer un effet de la folie (une certaine incohérence entre le réel et le phénoménal que le spectateur partagerait avec les personnages au niveau mental et au fur et au mesure de la durée de cet épisode dans le film), au lieu de montrer simplement la folie comme filmée de l’extérieur ou comme une grimace d’un personnage qu’on observe. Le théâtre peut donner la vision de la folie dite objective, vue de l’extérieur : belle mais absurde. Par exemple, la folie de Lucia di Lammermor dans l’opéra du même titre, à l’aide de la voix directe à laquelle on s’identifie fortement malgré tout (le côté subjectif y est présent, mais à travers la projection-identification seulement). Alors que le cinéma trouve bien le moyen de nous montrer les deux côtés – subjectif et objectif – où la folie n’est pas encore évidente (on se trompe, nous, en même temps que les personnages, comme dans Shutter Island de Martin Scorsese), en changeant le point de vue de la caméra mais aussi le « point de la voix » (entente d’une voix dans Psychose, par exemple, où on entend la voix du hors-champ et « on y croit »). Ou encore : dans Le testament du docteur Mabuse Lang parvient à construire – à l’aide du même procédé – un rapport à l’autorité secrète – donc impossible à filmer « telle quelle » – dans le milieu criminel ; on peut aussi reconstruire le problème de la personnalité du personnage lui-même comme dans le Miroir de Tarkovski, etc.
Le cinéma comme médium et comme un art audiovisuel « concret »
L’un des mérites de la théorie acousmatique (Schaeffer, M. Chion, F. Bayle, P. Henri, etc.) – solidaire alors de la perspective anthropo-sociologique et interdisciplinaire de E. Morin – est de se concentrer sur le « concret » comme sur la ressource matérielle et essentielle de l’art audiovisuel. Il est utile néanmoins de rappeler ici qu’une théorie de la pensée concrète était élaborée aussi par les formalistes russes et par Eisenstein. Ce dernier développe ces idées sur la pensée concrète mais aussi « sensible » dans son grand projet intitulé, comme chez Morin, la Méthode.
L’Audiovisuel – invention de la science – visait comme tous les biens techniques à faire son offre. Il propose en tant que médium d’améliorer la vie de l’être humain, en l’occurrence de faciliter son accès à l’information (comme la photographie permet d’étudier l’objet en le retirant du flou du mouvement ou de changement temporel, puis la radio nous laisse entendre la parole du président, la TV montre des événements variés, etc.). On croit souvent à tort que la première théorie des médias n’advient qu’avec Marshall McLuhan (1968) aux États-Unis. Une réflexion, cependant, suffisamment « complexe » – interdisciplinaire – autour de l’impact sur l’être humain de la radio, du cinéma et puis de la télévision surgit en France, presque deux décennies avant M. McLuhan. Cette enquête sur les médias que Pierre Schaeffer a initiée depuis les années 1940 [12] précède et conditionne l’instauration ultérieure de la théorie acousmatique [13].
Par définition, les media remplacent l’objet en question. Ils forment un medium entre le sujet, dont les capacités d’accès aux faits sont limitées, et l’objet qui est éloigné, obscurci, ou bien qui présente d’autres difficultés d’appropriation. En devenant art (cinéma, vidéo, etc.), l’audiovisuel quitte cette position intermédiaire qu’il occupait dans les rapports objet-sujet. Il aurait été logique de supposer que l’art audiovisuel se dirige vers l’objet, qu’il veuille devenir l’objet même. Cependant, non seulement le sujet ne disparaît pas, mais il acquiert une position centrale (auteur ou spectateur) et se transforme lui-même dans cette expérience. Le spectateur est persuadé d’avoir désormais l’occasion d’éprouver une expérience unique, très personnelle puisqu’elle s’effectue au contact avec un matériel très concret. Ce concret ne peut être présenté que comme très « subjectivement » transmis (découpage, cadre, etc.) mais il peut aussi prendre une forme abstraite grâce au montage.
Les nombreuses expérimentations radiophoniques de Schaeffer et ses recherches sur la musique concrète ont d’abord abouti à la conception suivante: dans la musique traditionnelle, on part des notes (unités « idéales ») et des idées-mélodies d’abord pensées et écrites. Elles trouvent leur expression concrète seulement lorsqu’un musicien déchiffre un document. La musique concrète, tout au contraire, cherche à partir d’abord des sons « chosaux » et « concrets », repérés et recherchés dans la vie, pour ensuite constituer une mélodie lorsqu’on assemble ces bruits et sons.
Il convient alors de se demander : le cinéma, ne serait-il pas, lui aussi, un art « concret » au sens de P. Schaeffer ? Les choses réelles y sont filmées et mises en une ligne de montage et elles nous offrent ensuite une histoire intelligible. Quoique le cinéma parte souvent (mais pas toujours) d’un scénario, on y fait néanmoins certains essais avant le tournage; l’équipe pratique des prises de vue, essaie des pellicules ou, aujourd’hui, des formats vidéos, pour voir si le projet tiendra dans son objectivité prétendue, si l’acteur est photogénique, si un paysage ou un geste « entre » dans l’objectif, etc.
Victor Chklovski – l’un des formalistes russes – dans son livre sur son ami Eisenstein, reprend le raisonnement de ce dernier:
« Au cinéma nous avons les cadres, c’est de la photographie. Un chien est toujours le chien concret, une vache est toujours la vache concrète, exactement cette vache-là. En littérature, nous précisons un mot par un épithète, par une description, c’est-à-dire, nous allons de l’abstrait vers le concret. Au cinéma, nous montrons le concret et c’est en introduisant une phrase de montage que nous en faisons de l’abstrait. » [14]
« Phrase de montage (montajnaya fraza) est une notion qui désigne un principe de montage chez les formalistes russes. Selon eux, le montage devrait se constituer comme langage par les phrases, les périodes et impliquer d’ailleurs des figures rhétoriques, comme la « ciné-métaphore », par exemple. Il faut ajouter que la curiosité de Morin pour la rhétorique cinématographique apparaît dans son texte comme à travers son intérêt pour les cinéastes soviétiques, notamment, pour Alexandrov, Eisenstein, Poudovkine, Vertov, etc.
Pour les formalistes (Chklovski), comme pour Eisenstein, la pensée cinématographique se déroule comme une dialectique [15] du « concret-abstrait ». Il ne s’agit pas seulement des images abstraites ou concrètes, mais du concret des personnages. Ce concret est rattaché aux être humains, comme à tel ou tel type d’individu que montre le film au public. Chklovski en conclut qu’Eisenstein fut beaucoup plus que ce qu’il se figurait être lui-même. Tout en étant cinéaste, il a apporté des contributions très variées sur l’humanité.
Les différences profondes entre le cinéma et la littérature n’ont pas empêché les formalistes de développer leurs idées du « ciné-langage » et de la « poétique du cinéma » qui se constituent par des procédés [16]. Comme Morin, ils considèrent le cinéma en tant que source précieuse d’une nouvelle anthropologie dans la mesure où il s’appuie sur ces figures rhétoriques, poétiques, non-rationnelles [17]; il y a une parenté entre la pensée spontanée et les procédés filmiques. Cette distinction montre en effet qu’un procédé cinématographique de base vise à devenir la pensée –éventuellement très abstraite – du spectateur : être reçu, lu et compris au sens qu’on lui attribue lors de la création.
Les procédés cinématographiques dits naturels : les ombres et les voix « caverneuses »
Faisant écho à la théorie de Morin, à savoir que le Double des ombres de la caverne – le premier porteur des projections-identifications – fut le « moteur » de la culture (philosophie, théâtre, littérature, religion, etc.) et surtout du cinéma, il serait opportun de nous interroger sur cette projection en tant que procédé pré-cinématographique et expression de la « déraison ». Notre interrogation est en effet double: il y est d’abord question d’une projection lumineuse purement physique et de la projection au sens psychologique, comme investissement de l’esprit humain dans l’image obtenue, en plus du travail pratique avec cette image.
Certes, les grottes et les cavernes ont été sollicitées à plusieurs reprises en tant que sources de et par la philosophie avec Platon, mais aussi par l’esthétique. Georges Bataille, par exemple, effectue une véritable célébration de l’art pariétal en tant que précurseur de la peinture [18]. Vingt ans après Morin, vers 1975, Jean-Louis Baudry dans son fameux article sur le dispositif [19] développera une approche critique du rapprochement entre le cinéma et la caverne platonicienne du point de vue de la psychanalyse. Cependant, dans la perspective morinienne de la sociologie anthropologique, dans quelle mesure convient-il de chercher les mécanismes pré-cinématographiques qui « engageraient l’esprit humain » au stade pré-culturel de « l’enfance » de l’humanité dans les cavernes ?
À titre purement hypothétique, suivant Morin, la toute première correspondance qu’on trouve entre l’expérience cinématographique et celle de regarder les ombres chez les hommes préhistoriques – où, il est vrai, il n’y a pas encore de procédés au sens propre, mais certains principes inopinés – tient à la manière de traiter, de manipuler et d’observer ces ombres, – c’est la projection elle-même. Ainsi, – et la chose est explicite chez Morin – l’ombre caverneuse fait naître le théâtre des ombres. Le « pré-théâtre » des ombres n’a pas encore – supposons-nous – son règlement, il est spontané et inscrit dans le quotidien de l’homme de la caverne en tant que jeu. Une ombre animée de manière artificielle, par « jeu », est reconnue et inscrite dans la dimension d’un au-delà. Son accueil se fait au prisme de l’altération, d’une transcendance, car elle n’a pas de visage : elle n’est qu’une ombre. Le fait que l’homme préhistorique commence à « jouer » avec une ombre – et de lui prêter sa voix - ne veut certainement pas dire qu’il a cessé d’en avoir peur [20].
Le cinéma n’a fait que développer cette manipulation jusqu’à un plus haut niveau : les ombres des choses tracent les surfaces argentiques de la pellicule au lieu de rester sur les murs, puis elles sont de nouveau projetées sur une surface lisse et claire. Le mur de la caverne – même s’il n’était pas plat – a servi néanmoins comme écran pour ces ombres, un espace toutefois limité qui nous donne une première notion du cadre.
Il est tentant de supposer ici que l’importance de cette étape dans le développement de l’être humain – de l’inscription des images-formes-ombres dans le cadre d’un mur – ne vient pas uniquement de ce qu’elle donne lieu à l’art de la peinture et à la fiction, mais d’abord peut-être à l’émergence du point de concentration de l’attention commune sur les choses vues de la même perspective. Pour que la reconnaissance d’une image unilatérale ait lieu, il faut que l’homo acquière cette capacité de « redresser dans l’esprit » – pour reprendre une expression de Merleau-Ponty – le « reste » de l’objet lorsqu’on en voit une surface ou une forme. Le cinéma aurait reposé entièrement sur cette attitude.
Il est important que l’objet « commun » de l’attention publique – en tant que forme primitive – ne soit pas fourni naturellement, mais provoqué artificiellement. Il est rare, semble-t-il, dans la nature, sauf avec les objets très éloignés, d’avoir une perspective de vue commune. Ces images « universelles » – les silhouettes humaines et animales au loin, mais aussi les mains négatives – seront donc les premières à être soumises à l’épreuve de la reconnaissance dans l’art pariétal . Montrer quelque chose au public aurait été déjà un geste culturel.
On ne peut que s’entendre sur le fait qu’au cinéma, la reconnaissance des formes joue un rôle très important : pour que l’histoire filmique puisse être « imaginable » et constructible, il faut la reconnaissance totale des objets présentés alors que la caméra ne nous en donne qu’une surface et une seule perspective. Encore risquerons-nous alors de supposer que cette « provocation » – la trouvaille de ce point commun de vision sur l’objet – permet d’abord la reconnaissance de l’objet par la société des cavernes et seulement ensuite adviendrait une fonction « magique » de ces images dont parle Morin – où dessiner un objet aidera à l’atteindre lors de la chasse. Ici, en l’occurrence, il s’agit d’une « magie » pré-cinématographique des projections-identifications mais dans sa version archaïque ou naïve. Dès qu’on trouve ce moment commun de la reconnaissance des formes, on peut avancer plus loin dans le « travail pratique » avec les images, dans la production des interprétations, des modifications, etc. Morin suggère que c’est le moment « réaliste », fidèle aux formes qui lance le « fantastique » :
« Dès les origines de la représentation graphique ou sculptée, apparaît en même temps qu’une tendance à la déformation et au fantastique, une tendance réaliste par le silhouettage fidèle et la vérité des formes. Les Combarelles, Lascaux, Alta-mira nous en ont conservé les témoignages. Ces premiers et étonnants daguerréotypes des cavernes, jouaient, dans les rites d’envoûtement pratiqués pour la chasse ou la fécondité, le rôle de doubles médiateurs qui permettaient l’action sur les originaux ».
En effet, Morin ne divise pas ces deux étapes – « réaliste » et « fantastique » – à ses yeux, quoique successivement, elles s’effectuent presque simultanément. Supposons, alors, que c’est dans cette tentative d’atteindre l’« original » de manière magique, qu’advient la concrétisation du medium.
Un autre principe « ciné-caverneux » serait aussi l’invention de la négativité picturale : une main jette une ombre sur le mur, lorsqu’elle est tenue près du feu. L’envie d’enregistrer cette trace de la lumière – qui emballe littéralement la main quand on voit son ombre – pousse l’être humain à en chercher le moyen. Ainsi, appuyée contre le mur, la main est couverte de peinture colorante. Il est inutile de rappeler ici que la pellicule a gardé le même principe de la négativité: c’est la lumière qui dessine les contours des objets et imprime la couche argentique placée sur le mur d’une petite chambre obscure.
D’après de nombreuses données et théories anthropologiques, environ un million d’années se déroule entre le moment où l’Homo Ergaster ou Habilis [21] apprend à obtenir le feu (en frottant les objets) en libérant donc les premières ombres et le moment où il le maîtrise totalement (en préparation de la provision après la chasse) en devenant l’espèce qu’on a nommée – peut-être injustement selon Morin – Homo Sapiens. Un million d’années d’aventures avec le feu ! Face à cette période, les derniers deux mille ans apparaissent comme ceux du progrès catastrophiquement foudroyant, et encore plus, ce dernier siècle des médias : siècle du cinéma et des technologies.
Les procédés cinématographiques ont ainsi une longue histoire qui commence avec la peur et le hasard et s’affirme avec le jeu. Certainement, le moment où l’être humain se dissocie de son ombre pour la laisser vivre sa vie imaginaire est un moment assez radical dans l’autodéfinition de l’être humain.
« Tu parles donc je suis » – « Je pense, donc le cinéma existe ».
Les années 1960 en France sont une période d’engouement autour des théories interdisciplinaires qui se forment sous l’impact de la psychanalyse, du structuralisme, de la linguistique, etc. Le dévoilement de l’homo doué de déraison – en dépit de Sapiens ou Faber – dans les écrits cinématographiques et anthropologiques de Morin [22] ne se fait pas certainement sans influence de et sur d’autres théoriciens, comme P. Schaeffer, par exemple. À partir de l’année 1960, un dialogue durable s’établit entre les deux penseurs [23]. Tout comme Morin, Schaeffer admet la nécessité de transgresser le paradigme classique, selon lequel l’homo sapiens serait la notion qui nous définit comme espèce. Selon lui, cette notion n’est certainement pas suffisante. Jacques Perriault, théoricien des médias et de l’informatique et auteur de l’Archéologie de l’audiovisuel [24] , s’étonne de la proximité des approches chez Schaeffer et Morin. Il interroge notamment Morin sur leur collaboration, avérée [25]. Les deux auteurs, comme le remarque Perriault, abordent les problèmes des médias, dévoilent leur inquiétude face à la globalisation des procédés informatiques, réalisent des films, effectuent des recherches expérimentales, construisent leur théorie sur l’être humain à l’époque contemporaine mais ne collaborent que pour quelques projets théoriques – surtout pour thématiser les problèmes du cinéma en 1960 et la crise de la science des années 1970 [26]– sans remarquer peut-être la solidarité évidente de leurs approches pratiques et artistiques. Ainsi, on trouve chez ces deux auteurs une critique du concept d’homo sapiens qui s’effectue à travers la prise en compte de l’influence des médias, et du cinéma en particulier, sur l’être humain et à travers aussi le dévoilement dans la conscience de ce dernier des processus jusqu’alors ignorés.
Le problème du devenir de l’homme impacté par le cinéma et d’autres médias est bien présent chez Schaeffer dès qu’il s’intéressa à la radio comme facteur acousmatique [27]. Mais c’est en 1985 qu’il fait se croiser et dialoguer dans une œuvre littéraire – non sans ironie sur cette crise déjà évoquée de la science – l’Homo Faber, le Sapiens, aussi bien que l’Habilis, l’Erectus et d’autres types historiques mais ici archétypaux de l’homo tous présents au sein d’un individu moderne– en l’occurrence, Schaeffer lui-même. Le dialogue débute par l’arrivée du Sapiens pour la rencontre avec Faber qui commence ainsi:
« - Tu parles donc je suis. Faber pense.
-Tu suis le bison, c’est tout ce que tu sais faire. Sapiens joue sur les mots.
- L’idée du piège, c’est toi, insiste Faber [28]».
La phrase de lancement du dialogue qui veut dire tout simplement « je t’écoute », au sens de suivre la pensée, est en même temps – ou aurait dû devenir – une devise acousmatique qui renverse la maxime cartésienne. Elle exprime en effet le passage entre deux stades de l’existence humaine. Le stade, d’abord, de l’être humain comme « suite » presque aveugle des circonstances dans lesquelles il existait, quand l’Homo Faber devait surtout faire quelque chose face aux conditions qui s’imposaient à lui. L’être humain ne se distinguait pas de la nature dans laquelle il existait, il « était » littéralement ce qu’il était en train de faire à l’instant précis de son présent. Son existence se réduisait à la survie, aux processus compliqués, à la succession des évènements « en direct » et aux réactions rapides. Et ensuite le stade où, à la place de l’instinct, advient la pensée comme outil ingénieur : pensée qui projette dans le futur de la chasse, pensée qui précède l’action, pensée qui ne correspond pas au « direct ». La planification rationnelle de l’action n’aurait-elle été au début qu’un fantasme de magie ? L’homme devient celui qui a pensé, prémédité ou imaginé un outil, il ne « suit » plus aveuglement n’importe quoi, il est celui qui pense en parallèle, analyse ou rêve de quelque chose. Ce dialogue imaginaire entre les homos archétypaux est une manière ironique schaefferienne de montrer que ce passage est purement métaphorique, ou bien qu’il fallait plus que les seuls Faber ou Sapiens, qu’il fallait les deux, et plus que les deux pour le progrès de l’évolution. La coexistence de l’Homo Faber avec Sapiens s’articule encore à l’âge où « le clou n’est pas encore inventé (comme le dit Faber), le langage non plus (dit Sapiens) » [29].
L’arrivée du cinéma, puis de la radio et de la télévision, avec le remplacement de l’objet en question par une sorte de simulacre « sans cause », comme le dit Schaeffer, ou par une retransmission cadrée, coupée, détachée de sa cause, est aussi un passage historique d’une forme de la conscience de l’homo moderne à une autre, celle de l’homo contemporain. L’homo ne vit plus depuis longtemps ses événements en direct, mais le moment de la pensée s’est encore plus décalé par rapport à l’événement, en transformant le présent en temps qui dure encore et se laisse observer. En un autre sens, cette offre audiovisuelle de suivre un événement médiatiquement (dans la salle du cinéma ou en écoutant la radio, internet aujourd’hui), n’est-elle pas en même temps une tentative de revenir à cet état sauvage ou la pensée coïncidait avec le direct de la vie ? De se libérer de la nécessité permanente de réfléchir à l’organisation pratique de cette vie et des soucis de nos actions ?
« Tu parles donc je suis » (avec un jeu de mots sur « suis », à la fois être et suivre) est ainsi la description de l’état de l’auditeur. Certes, on pourrait approcher ce dialogue comme quasi-shysophrénique à partir de la personnalité multidimensionnelle du personnage de Schaeffer lui-même – comme elle est élaborée dans son livre – dans laquelle « sont » à la fois Sapiens, Faber et d’autres homos. Cependant, Faber existe en Schaeffer puisque Sapiens y existe aussi et puisqu’il y parle. Faber existe tant qu’il est impliqué dans l’action, en l’occurrence comme auditeur, dans l’écoute immédiate (dans la « suivie » des propos).
Quant à la pensée de Sapiens – cette projection dans le futur ou dans l’imaginaire – l’audiovisuel l’a transformée en quelque chose qu’on peut suivre sans soucier de sa cause, comme un enfant libéré des soucis de la vie. Le tout premier dispositif acousmatique chez les pythagoriciens fut conçu, semble-t-il, justement comme instrument pour faire suivre la pensée, selon Schaeffer, sans y participer (concentration sur l’audible, interdiction de poser des questions, maximes à accepter sans en demander les preuves, etc.). Jean-Luc Godard suggèrera presque de la même manière une justification du cinéma dans sa fonction en une phrase fameuse : « Je pense, donc le cinéma existe ». Le cinéma est ainsi un dispositif permettant de décaler la pensée de l’événementialité réelle, et en même temps, de donner de l’événementialité à la pensée.
L’efficacité et le succès de l’audiovisuel, des médias dans leur totalité, si l’on peut dire, se cristallisent selon Schaeffer justement dans le fait que certains moments de la vie, voire tous, se trouvent comme sans cause. L’absence de cause a rendu possible la fiction cinématographique, celle aussi de la radio, mais aussi les « fraudes » dont parle Schaeffer dès les années 1940, les fausses croyances avec leur postérité actuelle (les fameuses « fake news »).
Dès lors le « Mythe » platonicien de la caverne, originellement une allégorie de la connaissance, ne demeure pas exclu de l’histoire du cinéma [30]. Morin fut sans doute l’un des premiers, à l’y intégrer [31].
Concernant l’origine de l’allégorie chez Platon, Morin ne cite qu’une hypothèse ignorée émise en 1938 [32]. Or ce qui frappe dans l’avancement des recherches actuelles sur l’histoire de la philosophie antique, c’est que l’origine du « mythe » est attribuée aujourd’hui à Pythagore [33], l’inventeur des concepts de l’« acousmatique » et du « nombre ». Platon aurait repris l’allégorie de la caverne de l’enseignement réservé aux pythagoriciens, d’où il aurait retenu aussi certains principes fondamentaux.
L’ombre de la caverne – le Double - serait alors acousmatique presque par définition : une ombre parlante qui joue sur l’énigme de sa provenance, elle est certainement le premier véritable « acousmêtre », si on reprend la terminologie de Michel Chion. C’est là que pour la première fois, l’homme cesse de réduire son existence aux réactions de la survie et s’adonne aux pensées et aux rêveries encore sauvages en créant le mécanisme pour les partager [34].
Cet acousmêtre « ombrageux » fait peur et attire en même temps, tant qu’il reste non identifiable, lorsque sa cause est en dehors des parenthèses du jeu. Ce jeu deviendra un jour le jeu de Koulechov et d’Eisenstein avec les morceaux-reflets du réel, d’un acteur du théâtre ou d’un réalisateur du cinéma. Ce jeu de détachement des causes, l’invention des causes fictives, et surtout le partage social, comme Huizinga l’a bien montré encore également en 1938, créa aussi l’Homo Ludens. Quelle serait sa réplique dans ce dialogue des facultés humaines ?
L’homme doué de déraison – de l’imagination, des rêves, des projections-identifications – cet Homo Ludens qui manipule ses ombres s’oublie lui-même et se réinvente sans cesse. Au bout de ce million d’année qu’il fallait pour la maitrise du feu, en se reconnaissant dans cette image à quatre extrémités, debout et répétant les mêmes mouvements, l’être humain découvre qu’il ne se souvient plus de ses origines. Ayant maîtrisé le feu et les ombres, il ne se souvient plus d’en avoir eu peur ni de son arrivée dans les grottes. Le cinéma n’est certainement pas le fournisseur de nouveaux fantasmes, ou, en tout cas, de ce point de vue, il n’est pas novateur. L’homo se nourrit des fantasmes dès son entrée dans la caverne [35], c’est-à-dire, dès le « début » de l’hominisation, dès son devenir homme qui est toujours en cours. Ces fantasmes sont « génératifs ».
Après cet éloge de ce qu’on appelle aujourd’hui la renaissance sauvage [36] effectuée par les médias, une réflexion plus critique advient cependant chez Morin. Encore une fois, Morin veut que cette réflexion s’exprime par le biais des médias eux-mêmes. Afin de nous parler de manière cinématographique de cet homme doué de déraison, Morin se lance, en 1962, dans l’écriture d’un projet de film de long métrage « multidimensionnel ». Ce film « envisage dans sa globalité le devenir actuel de l’espèce humaine, mais discerne des niveaux de problèmes différents » [37]. Les traits négatifs des médias contemporains qui apparaissent dans le projet du film donnent plutôt une image critique des médias en tant que culture des masses. Morin décrit la bande-Image au début du film : « Une succession de plans rapides nous fait passer d'un juke-box à la rédaction des journaux, à la production des films, des émissions radiophoniques. Une sorte de dialectique naît de ces confrontations entre le consommateur et le producteur » [38]. La bande sonore du film (« […] Une étude de Chopin, transformée en mélodie de juke-box, une mélodie de Beethoven transformée en cha-cha-cha et chantée par Dalida » [38]) fait également l’écho au retour vers l’état sauvage, décrit dans l’Homme Imaginaire, mais vu maintenant par Morin comme régression culturelle. Ce film, pour des raisons inconnues, n’a jamais été réalisé et Morin, lui-même, se détourne progressivement du cinéma et des médias. Une élaboration artistique de certains problèmes de cette époque trouvera une suite sous le patronage de Schaeffer qui tentera encore des dialogues avec Morin sur la transformation de l’être humain par les média, dans les années 1970-90. Néanmoins, le « texte » [39] de ce film, Les débuts de l’ère planétaire : Où va le monde ? [40] de Morin, n’est toujours pas écrit. Peut-être faudrait-il reprendre ce projet abandonné ? Que devient la pensée critique sur l’homo contemporain qui s’exprime par les médias et gravite autour des arts variés, y compris maintenant des arts numériques ? C’est une interrogation ouverte, qui invite à actualiser le projet de Morin au regard des transformations dans la diffusion du cinéma au-delà de la « caverne » de la salle obscure, et de l’omniprésence des flux audiovisuels sur des portables qui accompagnent désormais partout les êtres humains comme des prothèses quasi organiques.
Ekaterina ODÉ
Docteure en études cinématographiques et en philosophie
École Normale Supérieure, SACRe (Sciences, Arts, Créations, Recherches)
[1] SCHAEFFER Pierre, Faber et Sapiens. Histoire des deux complices, Ed : Pierre Belfond, Paris, 1985, p. 21.
[2] MORIN Edgar, Le Cinéma un art de la complexité. Articles et inédits 1952-1962, Paris, Nouveau monde éditions, 2018, p. 105.
[3] Ibid., p.117
[4] Ibid., p.118
[5] SCHAEFFER Pierre, Essai sur la Radio et le cinéma. Esthétique et technique des arts relais, 1941-1942, Édition établie par BRUNET Sophie et PALOMBINI Carlos, Paris, Allia, 2010 p.51.
[6] MORIN Edgar Op. cit., p.118
[7] La projection-identification est l’un des concepts centraux de Morin dans ses écrits sur le cinéma et désigne les opérations et les réactions psychiques chez le spectateur par rapport aux personnages vus à l’écran, mais aussi aux objets. Morin définit la projection-identification à travers la notion de la « participation affective », ou encore : « Le complexe de projection-identification-transfert commande tous les phénomènes psychologiques dits subjectifs, c’est- à-dire qui trahissent ou déforment la réalité objective des choses, ou bien qui se situent délibérément hors de cette réalité (états d’âme, rêveries) ». MORIN Edgar, Le cinéma ou l’homme imaginaire, Essai d’Anthropologie sociologique, Paris, Minuit, 1956, p. 93.
[8] On attribue généralement la théorie de la voix acousmatique au cinéma à Michel Chion. Cependant, ce dernier dans ses écrits (CHION Michel, La voix au cinéma, Paris, Ed. de l’Étoile/Cahiers du cinéma, 1982) développe largement les interrogations de P. Schaeffer, qui, lui aussi, a beaucoup écrit sur le cinéma et les mass-media, même s’il est surtout connu – injustement peut-être – pour ses expérimentations avec la musique concrète et acousmatique.
[9] MORIN Edgar, Les Stars, Ed. du Seuil, Paris, 1957 (rééd. : Coll. Points,1972 ; 2015)
[10] Le double un concept principale que Morin introduit dans Le cinéma et l’homme imaginaire: « Cette image fondamentale de l’homme, antérieure à la conscience intime de lui-même, reconnue dans le reflet ou l’ombre, projetée dans le rêve, l’hallucination, comme dans la représentation peinte ou sculptée, fétichisée et magnifiée dans les croyances en la survie, les cultes et les religions » MORIN Edgar, Le cinéma ou l’homme imaginaire, Essai d’Anthropologie sociologique, Paris, Minuit, 1956, p. 33. Ayant les « racines anthropologiques » (Ibid.) le double est « un Mythe universel dans l’humanité archaïque ». Chacun vit accompagné de son propre Double, continue Morin. Il détient la force magique (Ibidem. p. 34). Cependant, nous lisons chez Morin : « La qualité du double est projetable en toutes choses. Elle se projette, dans un autre sens, non plus seulement en images mentales spontanément aliénées (hallucinations), mais aussi en et sur des images ou des formes matérielles. C’est une des premières manifestations d’humanité que cette projection, par le truchement de la main artisane, d’images matérielles, dessins, gravures, peintures, sculptures. Ce qu’on appelle anachroniquement et improprement « art préhistorique » (p. 35).
[10] On notera qu’un film du même titre « Observateur observé » a été réalisé par Pierre Schaeffer en 1967, c’est-à-dire après Chronique d’un été de Morin et Rouch.
[11] Voir les écrits de Schaeffer des années 1940 sur la radio et cinéma (par exemple, SCHAEFFER Pierre, Essai sur la Radio et le cinéma. Esthétique et technique des arts relais, 1941-1942, Édition établie par BRUNET Sophie et PALOMBINI Carlos, Ed : Allia, Paris, 2010).
[12] Son successeur, Michel Chion, (l’auteur du concept acousmêtre au cinéma), inaugure sa recherche sur les médias avec Pierre Schaeffer au début des années 1970.
[13] ШКЛОВСКИЙ Bиктор Б., Эйзенштейн, Mocква : Искусство, 1976, c. 138. Traduit par nos soins. [Chklovski V. B. Eisenstein, Moscou : éd. Art, 1976, p.138. ]
[15] Sur cette dialectique eisensteinienne influencée par la philosophie allemande classique et notamment par J. W. Goethe, C.F. : VOGMAN Elena, Sinnliches Denken. Eisensteins exzentrische Methode, Ed.: Denkt Kunst, Diaphanes, Zürich, 2018, p.131
[16] Voir, par exemple, CHKLOVSKI V., EIKHENBAUM B., KAZANSKI B., MIKHAÏLOV E., MOSKVINE A., PIOTROVSKI A., TYNIANOV I., Poétique du film. Textes des formalistes russes sur le cinéma, Lausanne, L’Âge d’homme, 2008, Traduit du russe par POSENER Valérie, GAYRAUD Régis et PEUCH Jean-Christophe.
[17] Par exemple, le film Le Manteau (1926) de N. Kozintsev et L. Trauberg, où pendant le dialogue entre le personnage principal et un bureaucrate riche un plan sur le protagoniste en plongée, ce qui exprime une métaphore : « regarder quelqu’un de haut ».
[18] Cf. MONOD Jean-Claude, « L’art avant l’histoire, ou comment Bataille célèbre Lascaux », in L. FERRI Laurent et GAUTIER Christophe, L. FERRI, L’Histoire-Bataille, Paris, éditions de l’École des Chartes, 2006, p. 107-121.
[19] BAUDRY Jean-Louis, « Le dispositif : approches métapsychologiques de l’impression de réalité », in Communications, 23, 1975. Psychanalyse et cinéma. p. 56-72
[20] Supposons que le pas décisif dans l’« hominisation » se déroule dans les cavernes (car – reprenons la théorie classique – l’homo habilis obtient le feu il y a 1,5 million d’années – ce qui permet de ne pas avoir froid dans les grottes et ensuite advient l’homo erectus). Alors, le moment de la première non-reconnaissance de son ombre - que l’homme lui-même produisait involontairement sur les murs (ou d’une ombre de son voisin) - date du moment où l’espèce (homo) s’installe dans les cavernes. Une fois que l’homme s’habitue suffisamment aux ombres et tout au long de la maîtrise du feu, ce « reflet » lumineux devient peu à peu une sorte de miroir dans lequel l’être humain se reconnaît. Ce « stade du miroir » précède le stade de manipulation ou du « jeu » avec les ombres dans lequel s’inscriront plus tard les premières tentatives de tracer les signes sur les murs. Nous n’abordons pas ici la corrélation évidente avec le développement du signe et de l’écriture, car en parallèle d’autres supports furent probablement adoptés par les hommes préhistoriques (le sable, la terre, les grandes feuilles d’arbres) qui ne gardent pas les signes face au temps mais permettent le développement du dessin. Certes, les murs de la caverne ne furent pas les seuls porteurs de l’image. La culture préhistorique ne se réduit pas aux ombres et à l’art pariétal.
Certes, nous n’abordons cette étape de l’hominisation, faute des preuves scientifiques, qu’à travers les hypothèses et les théories qui existent. Toutefois, les choses naturellement vues de la même perspective n’auraient été que les phénomènes naturels : le ciel (la lune, le soleil, les nuages, etc.) ou les animaux à l’horizon pendant la chasse. Avec l’art pariétal, – supposons nous - la notion de l’horizon - avec ses arbres, les formes des pierres éloignées, les animaux et l’être humain – acquiert le statut particulier. La vision horizontale autorise la vision « primitive » de la forme, mais l’importance est que cette perspective du regard commun sur les choses soit reconnue par la société. On le sait aujourd’hui : les hauts primates savent dessiner, mais leurs dessins restent au niveau de la signification abstraite de la forme. Les enfants-humains ont aussi cette période abstraite dans les dessins, mais très vite ensuite, adviennent les éléments de la concrétisation. Cette différence pourrait en effet signifier que l’hominisation se déroule surtout entre le stade des dessins abstraits où on reconnaît la forme et le stade de concrétisation des dessins avec la reconnaissance des nuances. Sur les dessins des enfants et les arts primitifs Cf. les travaux de Georges-Henri Luquet. Sur la comparaison des dessins paléolithiques et dessins enfantins : LUQUET, G.-H., « Deux problèmes psychologiques de l’art primitif », Journal de psychologie normale et pathologique, (dir. P. Janet et G. Dumas), XXe année, n° 1-4, mai-juin 1933, éd. Lib. Félix Alcan, p. 514-542 ; et d’autres : LUQUET G.-H., La Pensée primitive, S. l. n. d., In-4°, fig. Extrait de « L'Évolution humaine », t. I, p.p. 323-354 ; DEPOUILLY, J., Enfants et primitifs. Etude comparative de la démarche créatrice chez l’enfant et l’adulte, Delachaux et Niestlé, 1964. À ces références on peut ajouter encore de travaux plus récents comme : FABRE Daniel, Bataille à Lascaux. Comment l’art préhistorique apparut aux enfants. Paris, L’Échoppe, 2014
[21] Nous nous référons ici à des notions de l’anthropologie classique contemporaine qui inscrit cette période entre 1.5 million d’années (ma) avant notre époque et environ 400000-300000 d’années av. J.- C. Il est évident que telle est la compréhension du passé humain à ce jour mais elle peut porter les modifications dans le futur en fonction des trouvailles, des découvertes et des nouvelles théories qui seront proposées.
[22] Cf. : MORIN, Edgar, Paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Ed. du Seuil, 1973 (rééd. 2016).
[23] Tout commence par l’invitation de Morin par Schaeffer à la participation à un débat sur le cinéma (« Micro et caméra ») avec M. Merleau-Ponty, C. Lévi-Strauss, R. Barthes et J. Rouch dans le cadre du festival de la recherche de l’(O.)R.T.F, organisé par P. Schaeffer. Sur cette rencontre voir notre article : « De la photogénie à la phonogénie et retour. Les aventures de la réalité face à l'œil cinématographique avec E. Morin » // Actes du colloque « E. Morin et le cinéma », mai 2018, Université de Caen, sous la direction de Valérie Vignaux [à paraître, 2019].
[24] PERRIAULT, Jacques, Mémoires de l’ombre et du son. Une archéologie de l’audiovisuel, préface de Bertrand Gille, Paris, Flammarion, 1981.
[25] LAULAN, Anne-Marie et PERRIAULT, Jacques « Interview d'Edgar Morin, 3 juillet 2007 », Hermès, 2007/2 (n° 48), p. 185-187.
[26] P. Schaeffer construit un nouveau projet interdisciplinaire de la recherche et de la lutte en même temps avec la situation de la crise qui régnait, qu’il intitule MURS (Mouvement Universelle de la responsabilité scientifique) dont Edgar Morin fait partie officiellement en tant que sociologue. Cf. : Imec, SCH88, dossier № 837, voir également la correspondance de P. Schaeffer avec E. Morin au sujet de leur collaboration : Imec, SCH247, dossier № 2129.
[27] Au concept « acousmatique » chez Schaeffer précède un autre : « phénomène radiophonique ». Ce n’est pas que la radio, mais tout le système audiovisuel (alors, cinéma d’époque) qui exploite ce phénomène : détache le son et l’évènement de sa cause. Schaeffer l’étudie puisqu’il trouve que l’usage qu’on en fait (1939-1980) ne vise que les intérêts politiques et de la propagande, alors qu’il y a autant de la liberté artistique alors inexploré, car l’influence des médias sur l’homme est exceptionnelle face à tout ce que connaissait l’histoire. Il revendique les recherches sur cette influence afin de rendre son usage plus réfléchi et outil en terme de moral public.
[28] SCHAEFFER, Pierre, Faber et Sapiens. Histoire des deux complices, Ed : Pierre Belfond, Paris, 1985, p. 21.
[29] Dans son film Les mains négatives, Marguerite Duras prononce une phrase similaire : « Le désir n’est pas encore inventé ».
[30] Après Edgar Morin, effectivement, plusieurs théoriciens et historiens du cinéma se sont rendus compte de l’importance des « cavernes » pour le cinéma. Par exemple, Nathan Andersen discute lui aussi les traits communs entre les procédés cinématographiques et l’expérience « caverneuse » décrite par Platon et des ombres sur l’exemple du film de Kubrick l’Orange mécanique. Également, Juliette Cerf dans son livre Cinéma et philosophie fait un parcours des rencontres possibles et des croisements entre la philosophie et cinéma qui débutent avec le mythe de la caverne. (Juliette Cerf, Cinéma et philosophie, éd. Cahiers du cinéma, « les petits cahiers », Scérén-CNDP, avril 2009).
[31] Jacques Aumont, dans Montreur d’ombre, critique une telle intégration de la caverne platonicienne en tant que dispositif cinématographique dans la genèse du cinéma par Jean-Louis Beaudry. Nous remercions M. Jean-Loup Bourget pour cette référence aux textes qui soulèvent les aspects critiques du recours aux cavernes effectué à partir de la théorie du cinéma.
[32] Morin précise que concernant l’origine du Mythe de la Caverne, il ne suit que l’hypothèse de Jean Przylinsky à savoir que « les cultes grecs de mystère pratiqués à l'origine dans les cavernes, s'accompagnaient de représentations d'ombres » (Edgar Morin, Op. cit., p.19). La seule référence qu’en donne Morin est : « Communication au Congrès International d'Esthétique, Paris, 1937 » Également, Jacques Derrida, dans la Dissémination en commentant le Chant de Maldoror, sans pourtant en proposer l’explication, renvoie l’allégorie de la caverne à la fois à l’« écran-miroir » et à des théories pythagoriciennes en utilisant, au lieu du « théâtre des ombres », la notion de « théâtre des Nombres ». C.f. : DERRIDA Jacques, La Dissémination, Seuil, Paris, 1972, p.360.
[33] Voir, par exemple, les hypothèses de BACCOU Robert, (La République, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1966, « Livre X », p. 485, note 754).
[34] Telle est également l’une des thèses centrales de l’ouvrage monumental de Hans Blumenberg, Höhlenausgänge, Francfort, Suhrkamp, 1988.
[35] Remarquons également que la caverne préhistorique devient elle-même un fantasme cinématographique, aussi bien que l’hominisation. Par exemple, l’ancien film britannique de 1966 One million years B.C., ou encore La guerre du feu (1981) de Jean-Jacques Annaud et bien sûr, 2001, l’Odyssée de l’Espace 2001.
[36] Nous utilisons ici le concept récent de Guillaume Logé qui développe une vision de l’art qui peut être considérée comme suite logique des processus observés par Morin dans la société actuelle. Cf. : LOGÉ Guillaume, Renaissance sauvage - L’art de l'Anthropocène, Ed. : P.U.F., Paris, 2019
[37] Cf. : Archives de l’Imec, Cote : 187MOR /196/2
[38] Ibidem.
[39] Cf. : l’image d’archive de l’Imec sur la première page de cet article.
[40] Ibidem.